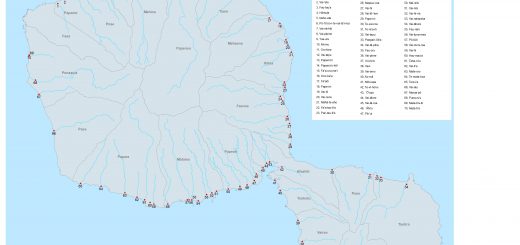« La culture, c’est ce qui est sédimenté en nous »
[singlepic id=437 w=320 h=240 float=left]
Ingénieur, communicant, écrivain, amateur de voile et d’histoires dans l’Histoire, Moetai Brotherson n’est pas toujours là où on l’attend et ne cesse de nous surprendre. De l’avenir du livre à sa vision de la culture, en passant par son prochain polar, Hiro’a a fait le point avec lui !
Qu’est-ce qui t’a donné le goût de l’écriture ?
Je crois que comme toutes les personnes qui écrivent, j’aime avant tout les histoires. Du gamin friand d’histoires que ma mère et mon grand-père me racontaient, j’ai évolué moi-même en conteur… D’abord oralement, puis en couchant mes récits sur papier. L’écriture permet de bâtir des histoires plus complexes, plus élaborées, figées aussi, mais au moins elles restent.
Tu as créé la surprise avec ton roman « Le roi absent », paru en 2007. Une belle aventure ?
A l’époque, on ne connaissait de moi que le technicien multimédia, mais pas forcément l’écrivain – hormis mes proches, à qui j’ai toujours fait lire mes manuscrits. « Le roi absent » est mon 8ème roman, c’est le premier et le seul qui ait été publié. J’écris avant tout pour moi-même, je ne comptais d’ailleurs pas publier. Mais suite au décès de ma mère il y a 4 ans, qui regrettait toujours que je ne fasse pas davantage partager mes histoires, j’ai eu une révélation. L’histoire du « roi absent » m’est apparue le matin de son enterrement. Il fallait que je l’écrive, c’était comme une urgence, elle prenait trop de place dans ma tête ! J’ai écrit pendant 3 mois, de manière ininterrompue. Ensuite, il y a eu des contacts avec plusieurs éditeurs et c’est avec Christian Robert (Au Vent des Îles) que le livre est né. Je dois dire que cette expérience fut vraiment gratifiante, en raison du retour des lecteurs, que je n’avais jamais connu auparavant.
Peut-on « vivre » comme écrivain en Polynésie française ?
Je ne pense pas, le marché est trop limité. Et indépendamment de cet état de fait, je n’ai pas, personnellement, cette ambition. J’ai besoin de vivre dans le monde « réel », d’avoir un travail, de rencontrer du monde sur un autre terrain que celui de l’écriture. Ce sont dans ces observations de la vraie vie que l’on pourra « colorier » les histoires de tous ces détails si justes, qui donnent au récit toute sa profondeur, sa subtilité.
Que penses-tu de la littérature polynésienne ?
On a des auteurs magnifiques ! Je pense par exemple à Titaua Peu, qui écrit avec une force incroyable. Mais aussi à Henri Hiro, Duro Raapoto. Il y a plusieurs littératures polynésiennes : la littérature « sur » la Polynésie, les auteurs polynésiens qui écrivent en langue française, et les auteurs polynésiens qui écrivent en reo ma’ohi. Cette dernière est malheureusement limitée, hormis pour les poèmes, les spectacles de danse et les pièces de théâtre. Autrement, il n’existe pas de roman en reo ma’ohi ; le seul ouvrage conséquent en tahitien, c’est la bible ! Le problème ne vient pas forcément du manque d’auteur, mais de la frilosité des éditeurs à sortir un livre en tahitien au regard du nombre d’acheteurs potentiels.
Nous sommes en plein salon du Livre spécial polar et il paraît que tu as un polar sur le feu… Tu es donc un adepte de ce genre littéraire ?
Oui ! Je suis fan de polar. J’affectionne particulièrement ce jeu entre l’auteur et le lecteur, les énigmes à découvrir, les fausses pistes à déjouer… Les polars scandinaves sont formidables – j’ai adoré la trilogie Millenium, de Stieg Larsson -, avec ces ambiances sombres, macabres… Lire ce genre de livre à Tahiti est dépaysant et, malgré la chaleur, on parvient à avoir des frissons ! Après, lorsque l’on est soi-même auteur, on ne lit plus tout à fait de la même manière. La construction d’un polar est presque mathématique. J’ai voulu écrire un polar mais sans « faire » du polar, pour surprendre les lecteurs.
Peux-tu nous en dire plus ?
Il va s’intituler « L’encre des âmes ». L’intrigue se déroule entre Tahiti, la côte ouest des Etats-Unis et la Chine. En fait, l’histoire est partie d’une question que je me posais : il y a eu 2 guillotinés à Tahiti au début du 19ème siècle – les 2 étaient Chinois – et je me demandais ce qu’étaient devenues ces guillotines. Après avoir fait quelques recherches, je suis tombé sur un élément croustillant, qui est le point de départ du livre. La suite début 2011, lorsqu’il paraîtra !
On parle beaucoup de l’avènement du livre numérique. Qu’en penses-tu ?
J’y crois beaucoup. J’ai à ce jour autant de « vrais » livres dans ma bibliothèque que de livres numériques dans mon téléphone. Je ne suis pas attaché à l’objet livre, mais au contenu. Aujourd’hui, je peux partir en voyage avec 1 000 livres sans qu’ils ne pèsent rien, c’est quand même formidable ! En tant qu’auteur, le modèle économique me paraît tout à fait valable, sauf pour l’imprimeur, qui devra trouver d’autres méthodes pour se renouveler. Chaque période connaît ses révolutions, ses changements de mode de vie et tout le monde fini par s’y retrouver, à condition d’y réfléchir. Le livre numérique ouvre des portes vraiment intéressantes, notamment pour les plus jeunes, qui lisent et écrivent beaucoup plus qu’on ne le croit sur Internet.
Quels sont tes projets actuellement ?
Pour le moment, je me concentre sur le voyage de la pirogue O Tahiti Nui freedom, dont je suis le capitaine à terre. C’est un projet un peu fou, initié par Hiria Ottino, et soutenu par l’association « Te vaka no te tau a u’iu’i » (www.otahitinui.com), qui consiste à faire le chemin Lapita sur une pirogue à voile, à l’inverse de nos ancêtres (Polynésie – Chine). Je suis un fan de voile et l’expédition d’Hiria m’a motivé, pour le défi sportif qu’elle représente comme pour son intérêt culturel. L’objectif sous-jacent, outre le fait d’arriver pour la clôture de l’exposition universelle de Shanghai, représentant pour notre pays un coup médiatique vraiment intéressant, c’est la crédibilité qu’on aura acquise avec une telle expérience. L’idée est de créer, à Tahiti, une école de voile traditionnelle. La pirogue O Tahiti Nui freedom a été construite à partir d’un plan authentique de l’amiral Paris, mais réalisée à partir de matériaux modernes. Son coût n’est pas très élevé et sa fabrication facile à répliquer. Deux critères indispensables pour ouvrir une école et faire connaître auprès du plus grand nombre cette technique de navigation ancestrale.
Quelle est ta définition de la culture ?
« C’est ce qui reste quand on a tout oublié » : je trouve cette formule bien connue très juste. On a oublié nos cours de mathématiques du collège, mais les connaissances liées à notre culture sont sédimentées en nous, elles sont tellement ancrées au plus profond de notre être qu’elles font presque partie de nos cellules ! Mais tout comme nous, la culture évolue : je ne suis pas le même aujourd’hui que celui que je serai au chevet de ma vie. Je trouve curieux de se dire qu’il y a ici des personnages qui sont de véritables puits de culture, et qu’ils vont disparaître sans que rien ni personne ne s’en aperçoive vraiment… La tradition de l’oralité dont nous sommes issus n’est malheureusement plus adaptée à notre société pour la transmission des savoirs ; chaque jour, on perd un peu plus de ces connaissances ancestrales. On ne pourra jamais les retrouver.
Si on te donnait un budget pour mener une action culturelle, que ferais-tu en priorité ?
Il y a une structure à Moorea que je trouve fantastique : Pu Atitia, présidée par Hinano Murphy. C’est une association de transmission du savoir, les plus anciens enseignent aux plus jeunes notre culture de manière ludique et concrète : faire un ahima’a, le tressage, la charpente, etc. Si j’avais un budget, je ferais donc une réplique de ce type de structure dans chaque archipel. Cela ne nécessite pas de gros moyens, mais il s’agit de trouver les bonnes personnes.